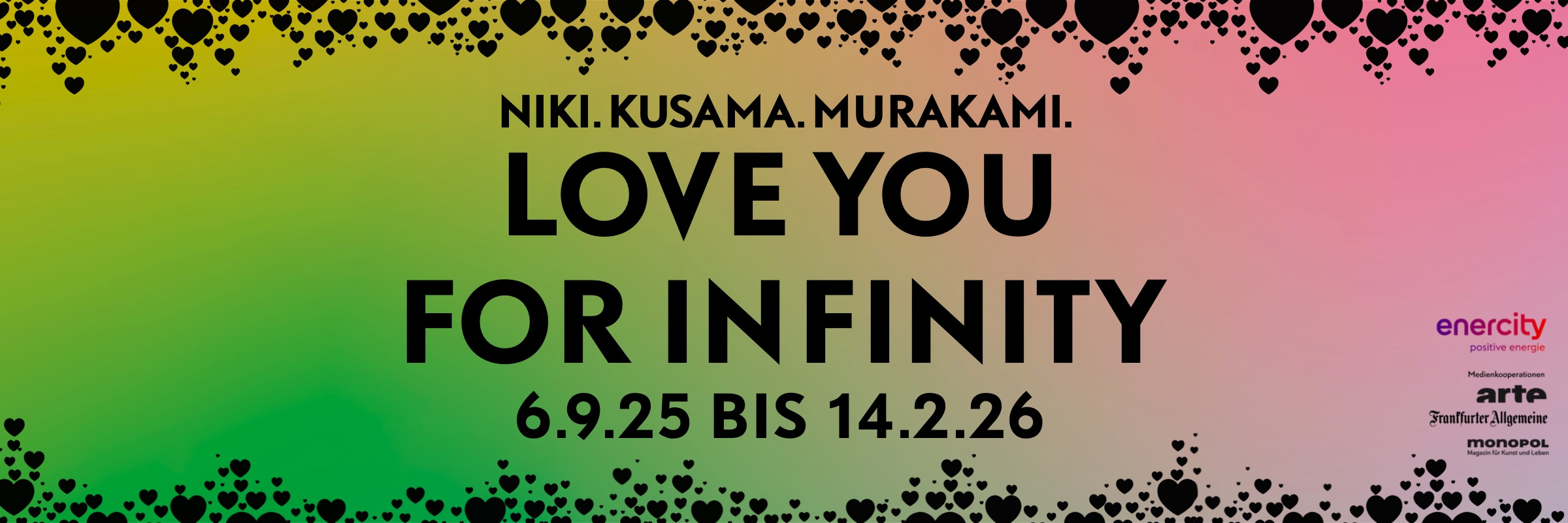Liselor Perez
Cent sommeils
Project Info
- 💙 Église Saint-Eustache, Paris
- 💚 Julia Marchand
- 🖤 Liselor Perez
- 💜 Julia Marchand
- 💛 InstanT Productions
Share on

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions1
Advertisement

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions2

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions3

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions4

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions5

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions7

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions11

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions12

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions13

Cent Sommeils, Liselor Perez, Beaux-Arts de Paris, courtesy Rubis Mécénat, église Saint-Eustache, 2025. Photo - InstanT Productions14
Des pantins et un bonhomme ont pris place dans l’église Saint-Eustache.
Ils sont au nombre de quatre, répartis dans différents endroits de la nef
principale et des chapelles latérales. Ils ne forment pas un groupe mais
semblent appartenir à deux familles plus ou moins identiques : celle des pantins,
partiellement constitués de tissus, et celle du bonhomme au corps solide.
Toutes sont des œuvres, conçues, pensées par l’artiste Liselor Perez pour
cette nouvelle collaboration entre Rubis Mécénat et les Beaux-Arts de Paris
avec l’église Saint-Eustache.
Au cours d’une longue période de recherche l’artiste a pris la mesure de l’église
pour répondre à une problématique qui pourrait être résumée de la sorte :
comment ces pantins, qui arborent généralement une attitude enfantine proche
de l’univers de la poupée, peuvent-ils prendre place dans cette immensité de
pierre, dans ce lieu de partage et de prière. C’est à partir d’un silence intérieur,
de la matérialité même de l’église et de ses revêtements muraux, que Liselor
Perez a dessiné des silhouettes mystérieuses qui tendent à se confondre avec
l’environnement dont elles émergent. C’est le cas, précisément, d’un personnage
qui arbore une posture de recueillement malgré sa taille plus grande que nature.
Considéré comme « un gardien de l’église », il est quasiment assis au sol, bras
encerclés autour de ces images, la tête dans ses pensées. Son corps est
recouvert de jesmonite pour ainsi se confondre dans le pilier derrière, ou plutôt,
pour donner l’impression qu’il en émerge. Car, dans le travail de Liselor Perez
il n’est pas question de camouflage, ni même de simulacre. Elle vient davantage
sculpter un point de jonction entre l’œuvre et son environnement pour faire
décoller un imaginaire, ici proche de la science-fiction. L’œuvre, en cela, induit
une spéculation sur les raisons de la présence du personnage, redoublée d’une
interrogation sur les nombreuses ornementations qui recouvrent son corps :
bras colonnes, torse brique, feuille d’acanthe qui court sur l’épaule et faisceau
sur le visage. Cette grammaire architecturale et ornementale est aussi celle
de l’église, signalant une interprétation libre d’un classique du maniérisme
avec la sculpture de l’Inachevé de Michel Ange, dont la posture semble émerger
tout droit de la roche spongieuse qui l’épouse. Liselor Perez nous murmure
également qu’il est impossible d’extraire l’être humain de son contexte.
Dans une époque qui réfute le hors-sol, cela va de bon ton.
Plus loin, dans une des chapelles latérales, un être-pantin semble tenir
dans une position d’équilibre. Tout comme le bonhomme à la colonne, il est seul.
Mais ici son corps est traversé par une dynamique fragile qui le maintient,
légèrement, en position debout. Là où le silence enrobait l’être de pierre,
ce pantin se voit affublé d’une lumière. Son visage devient le réceptacle
d’un éclairage-vitrail, entretenant ainsi un lien avec les panneaux de verres
sertis et assemblés qui se trouvent au-dessus de nos têtes. Là encore, il s’agit
de faire jonction avec le pantin et son environnement, d’absorber les motifs
qui l’entourent pour le couvrir d’une parure. Ici, les espaces ajournés se font
plus nombreux. Pour l’artiste c’est une invitation à la rêverie, une fenêtre
sur un monde. De même, les motifs en volumes qui apparaissent lorsque nous
nous rapprochons de ces êtres-pantins, nous dévoilent quelques secrets.
Et jusqu’où pouvons-nous aller dans leur intimité ?
Dans un troisième lieu, au-dessus de tombes et dans l’entrebâillement
d’une porte qui semble condamnée, l’artiste a disposé un autre pantin,
qui, cette fois, semble réuni dans une conversation secrète avec un partenaire.
Assis, vulnérables, ils n’en demeurent pas moins campés dans un silence narratif
qui nous amène au-delà de la simple représentation. Ce que nous voyons est
aussi un sentiment, une atmosphère, une interrogation incarnée sur le sens de
l’être et l’autre. En cela, l’artiste se place en digne héritière de pratiques
sculpturales affectives, qui caractérisent notamment le travail de Cathy Wilkes
ou de Gisèle Vienne. Le pantin n’est pas la métaphore de la manipulation,
il est le lieu d’une métaphysique.
Julia Marchand